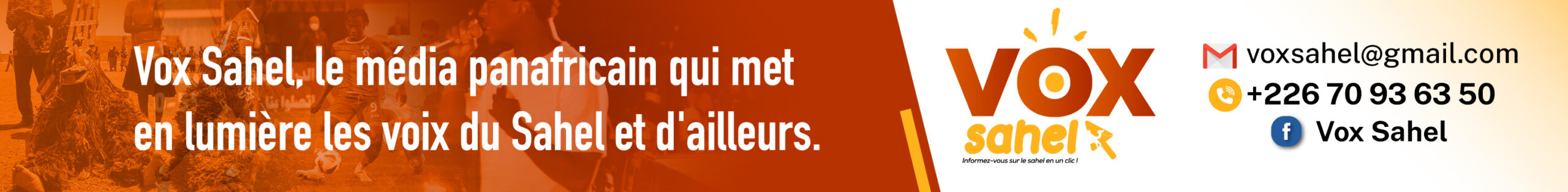Portrait/Salam Zampaligré : l’engagement au cœur du cadre

Parmi les visages du cinéma burkinabè contemporain, Salam Zampaligré s’impose avec une discrétion volontaire, mais une force narrative percutante. Né le 3 juillet 1980 à Ouagadougou, ce réalisateur appartient à une génération d’auteurs africains pour qui la caméra n’est pas un simple outil de création, mais un vecteur de résistance. Cinéaste engagé, coordinateur du Collectif Génération Films, il fait du septième art un espace de combat, d’alerte et de mémoire, capturant les fractures sociales et politiques de l’Afrique d’aujourd’hui.
Un détour par la communication, un destin façonné par l’image
Rien ne prédestinait Salam Zampaligré à se frayer un chemin dans le monde du cinéma. C’est pourtant en 2001, après des études en communication, qu’il choisit de s’orienter vers une carrière cinématographique. Attiré par la puissance de l’image, il trouve dans ce médium un langage capable de faire entendre les colères muettes et de rendre visibles les marges. En 2007, il décroche un master professionnel en réalisation de fiction à l’Institut Supérieur de l’Image et du Son (ISIS) de Ouagadougou, une étape fondatrice dans l’élaboration de son style.
Entre fiction et documentaire, un cinéma sans concessions
Salam Zampaligré explore avec rigueur les zones grises de la société burkinabé et africaine. Dès ses premiers courts métrages, il affirme une voix singulière : Juste un peu d’amour (2007), Béodaré (2008), Une lettre au Président (2010) ou encore Exil, les voix des sans voix (2012) sont autant de cris d’alerte, de regards acérés sur les abus, les injustices et les non-dits. Son cinéma, oscillant entre documentaire et fiction, ne cherche ni à séduire ni à enjoliver, mais à interpeller.
Son premier long métrage, La République des corrompus (2018), dresse un portrait sans fard des méandres du pouvoir. En 2022, il récidive avec Le taxi, le cinéma et moi, une œuvre introspective qui mêle mémoire, regard social et mise en abyme. Ce film recevra en 2023 le Prix du film documentaire au 12ᵉ Festival du cinéma africain, consacrant un parcours cohérent, discret mais essentiel.
Ce qui distingue Salam Zampaligré, c’est sa capacité à faire surgir l’émotion sans grandiloquence, à donner voix aux invisibles sans voyeurisme, à convoquer l’histoire sans nostalgie. Il capte son époque avec la précision d’un documentariste et la sensibilité d’un conteur. Dans un contexte où la liberté d’expression reste fragile, son œuvre s’érige en contre-pouvoir, en trace vive d’un continent en mouvement.
Plus qu’un cinéaste, Salam Zampaligré est un veilleur. Par son regard affûté, il documente, interroge, bouscule et surtout, il rappelle que le cinéma africain peut être à la fois esthétique, politique et profondément humain.
Par Vox Sahel